Les chiens radioactifs de Tchernobyl : un mystère génétique sans lien avec l'accident nucléaire
Après la catastrophe nucléaire dévastatrice survenue à la centrale de Tchernobyl le 26 avril 1986, les zones environnantes restent dangereuses pour l'habitation humaine. Pourtant, la zone d'exclusion est devenue un refuge surprenant pour la faune, y compris pour une population florissante de ce que l'on appelle aujourd'hui « les chiens radioactifs de Tchernobyl. » Ces chiens résilients, descendants d'animaux abandonnés au moment de l'accident, ont dépassé les attentes et ont fait l'objet de recherches génétiques révolutionnaires.

La vérité qui se cache derrière leur génétique
Malgré leur proximité avec l'épicentre radioactif, une étude récente révèle que les différences génétiques observées chez ces chiens ne sont pas le résultat de mutations induites par les radiations. Plus de 1 000 chiens parcourent la zone d'exclusion, dont 302 ont été étudiés de près par des chercheurs du Université de Caroline du Sud et le Institut national de recherche sur le génome humain. Ces chiens appartiennent à trois populations distinctes, vivant soit à proximité de la centrale nucléaire, soit dans un rayon de 10 à 15 kilomètres du site « Ground Zero ».
À l'aide d'analyses génétiques avancées, les chercheurs ont découvert traits génétiques distincts parmi les chiens. Cependant, l'étude suggère que ces caractéristiques n'ont pas été causées par les radiations. Ils pourraient plutôt être le résultat de pressions environnementales ou de facteurs génétiques préexistants qui ont amélioré la survie des chiens.

Des découvertes surprenantes
Le chercheur principal Matthew Breen explique la méthodologie : « Nous avons commencé par rechercher des anomalies chromosomiques, zoomer sur des régions génomiques plus petites et enfin analyser les différences au niveau des nucléotides. » Les résultats n'ont montré aucune preuve claire de mutations induites par les radiations.
L'étude soulève plutôt la possibilité que les chiens aient subi sélection naturelle extrême à la suite de la catastrophe. Megan Dillon, co-auteure, émet l'hypothèse suivante : « Il est possible que les chiens survivants possédaient déjà des traits génétiques qui les rendaient plus résistants. Ces caractéristiques auraient pu être transmises de génération en génération. »
Les défis environnementaux au-delà des radiations
Les radiations ne sont pas le seul défi auquel ces animaux sont confrontés. Des chercheurs, dont Norman Kleiman de la faculté de santé publique de l'université de Columbia, soulignent que la zone contient d'autres substances nocives, telles que les métaux lourds, la poussière de plomb, les pesticides et l'amiante. Ces toxines, libérées au cours de décennies de nettoyage, ont probablement joué un rôle dans l'évolution de la santé et de la génétique de la faune locale.
Des implications plus larges pour l'humanité
Étudier les chiens de Tchernobyl ne consiste pas seulement à comprendre leur survie. Les chercheurs pensent que ces résultats pourraient avoir des implications importantes pour la santé humaine. « Ces chiens offrent un aperçu des risques auxquels les humains pourraient être confrontés lors de catastrophes environnementales similaires », explique Kleiman.
À mesure que nos sociétés deviennent plus avancées sur le plan technologique et industriel, la probabilité de catastrophes de grande envergure augmente. Comprendre comment les espèces s'adaptent, ou ne parviennent pas à s'adapter, à des environnements aussi extrêmes est essentiel pour les futurs efforts de préparation et d'atténuation des catastrophes.
Le chemin à parcourir
L'étude se poursuit alors que les chercheurs s'efforcent de déterminer si d'autres facteurs environnementaux, tels que l'isolement ou la rareté des ressources, ont contribué aux distinctions génétiques des chiens. Les résultats pourraient non seulement approfondir notre compréhension de l'évolution sous la contrainte, mais également éclairer les stratégies visant à protéger à la fois la faune et les humains dans des environnements dangereux.

.avif)
.avif)


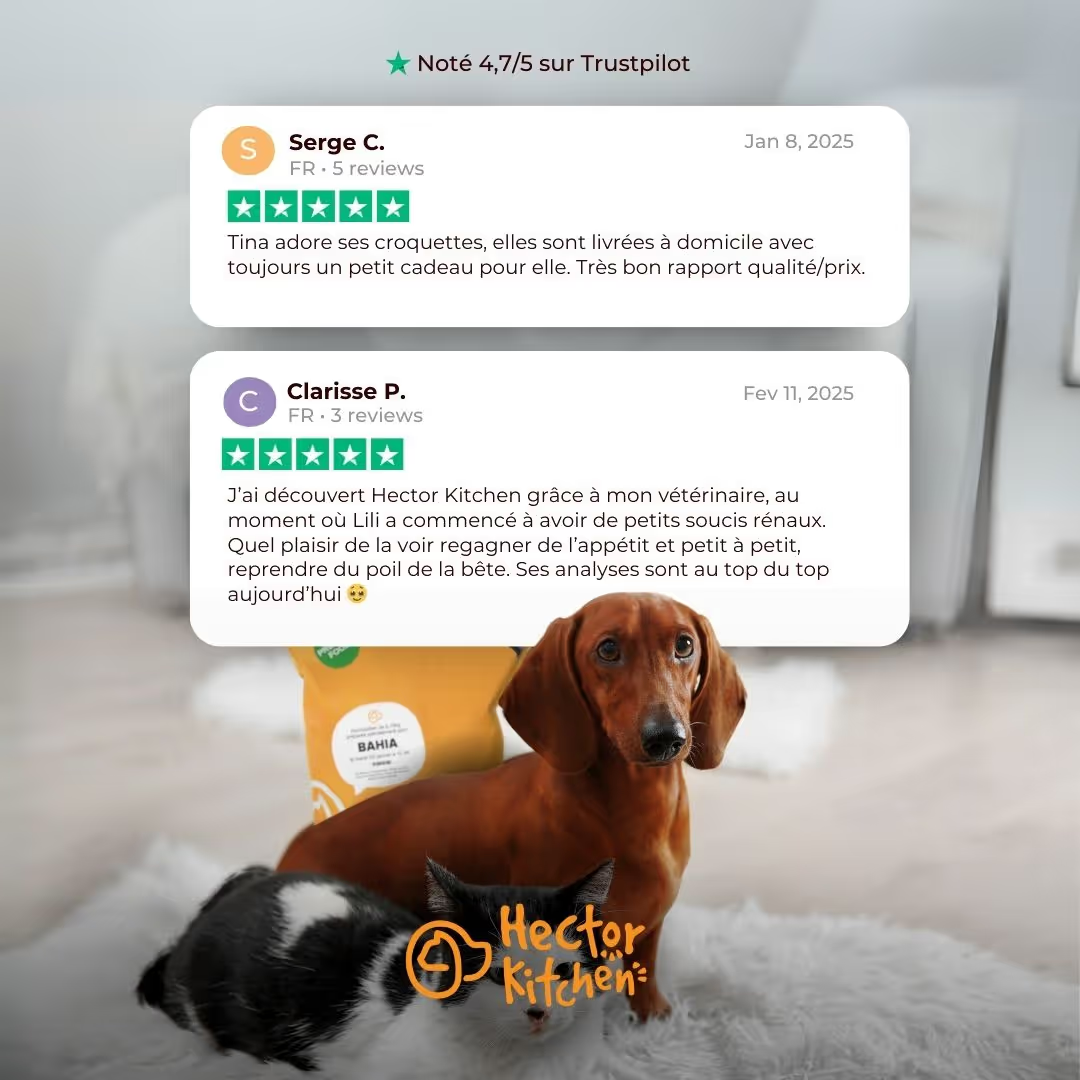


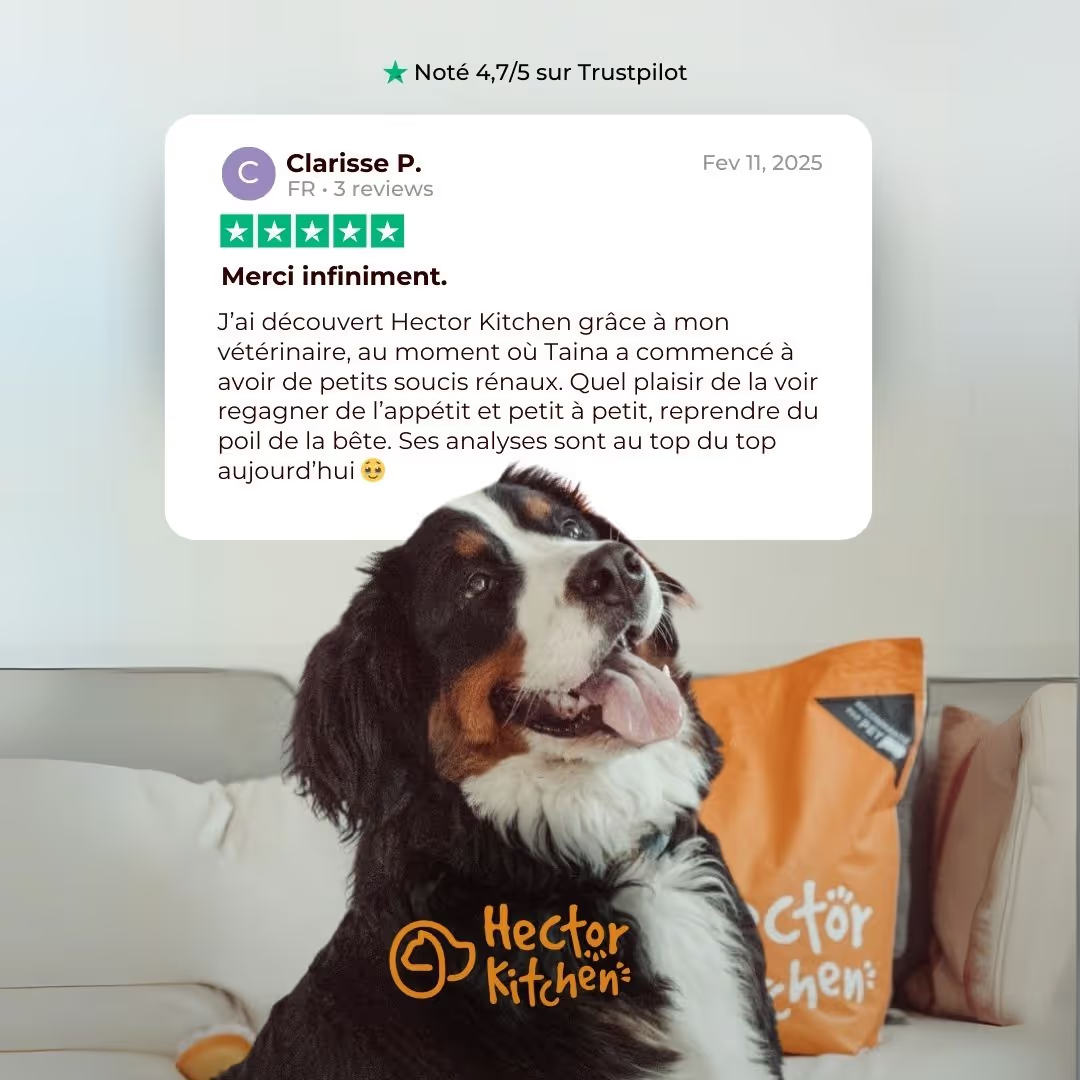

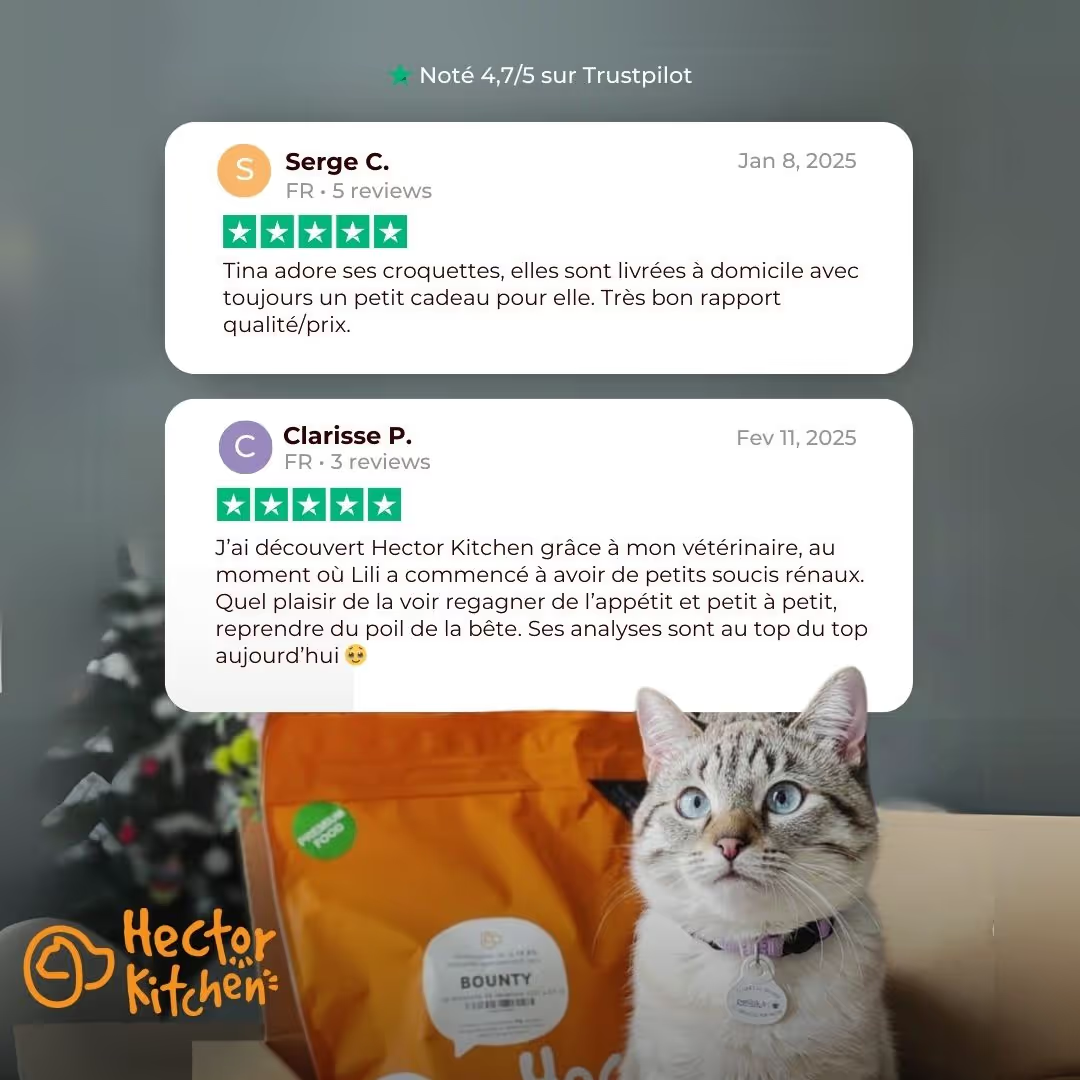




















.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)

.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.jpg)
